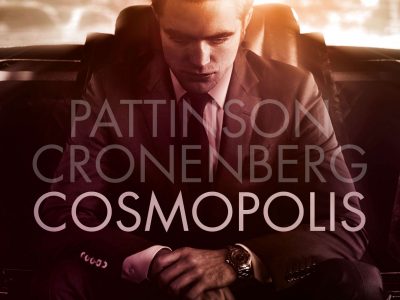Éloge de l’incongruité
Éloge de l’incongruité
Un bon spectateur ne choisit pas un film par hasard. Ça serait vraiment n’importe quoi. Déjà, celles et ceux qui se déplacent pour un acteur ou parce que l’affiche est jolie, je ne vous raconte pas. Mais il y a pire, ceux qui se pointent la gueule enfarinée devant la caissière de leur cinéma préféré en lançant : « Salut Laure, je voulais voir Les amants du Texas parce que le titre est chouette » « Ah oui ? J’ai cru comprendre que c’était du sous-Terrence Malick » « Mince. Et tu passes quoi d’autre à 14h ? » « Tip top. Ça a l’air plus rigolo déjà » « Ah. Tu l’as pas vu du coup ? » « Non, pas encore. Tiens ta place, c’est la salle 2 ». Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire que je suis quelqu’un de très influençable. Mais vous pourriez également interpréter cet épisode comme une sorte de « lâcher-prise cinéphilique », une volonté inconsciente de bousculer les lignes de la critique moderne en prenant des risques…
Et pour aller dans ce sens, figurez-vous que Tip top est un espèce de machin totalement azimuté et honnêtement, je ne sais pas par quel bout le prendre. Bon, ben commençons par l’histoire, on verra où ça nous mène. À Lille – qui comme chacun le sait s’est exilé au Luxembourg pour des raisons fiscales évidentes – un indic algérien est retrouvé assassiné dans un quartier populaire. La police des polices, craignant une dénonciation interne, dépêche sur place son plus fin limier (Isabelle Huppert) en lui collant dans les pattes une adjointe un peu nunuche (Sandrine Kiberlain). Leur enquête les pousse à s’intéresser aux trois flics référents de la victime dont Robert Mendes (François Damiens), un drôle de personnage. Tous les éléments sont réunis pour nous proposer un polar bien plombant dans la grande tradition du genre, avec contexte politique tendu – les émeutes en Algérie – et cadre social délabré – tout se passe dans un quartier populaire de la ville. Sauf que l’intrigue n’est qu’un prétexte et la composante politique est totalement désamorcée par une séquence d’ouverture d’anthologie : Damiens débarque dans un bar fréquenté par des algériens en insultant tout le monde et déclenche une bagarre générale traitée de manière burlesque. Ça calme. Quant au cadre social, personne ne s’attarde vraiment dessus. Attention, hein ? Ces éléments existent concrètement tout au long du film, que ce soient l’enquête avec ce qu’il faut de meurtres et de résolutions, l’Algérie qui s’invite frontalement via la retransmission des émeutes à la télévision ou la précarité de certains protagonistes englués dans la misère. Non, c’est juste que ça n’intéresse absolument pas Serge Bozon en tant que moteur narratif. Super. Passons à la mise en scène alors. Eh bien, c’est plat. Mais pas plat du genre « je ne sais pas donner de relief à ce que je filme », non. C’est volontairement plat. Et c’est volontairement moche, au niveau des décors, des costumes, de la musique… Il n’y a rien à quoi se raccrocher. C’est bien beau, mais qu’est-ce qu’il reste alors ? Les acteurs peut-être (rires) ?! Eh bien oui, les acteurs qui s’amusent comme des petits fous. Il faut dire que le réalisateur leur a taillé des rôles sur mesure, à la limite de la caricature afin qu’ils se sentent à l’aise et se fassent plaisir. Damiens, par exemple, n’a jamais été aussi bon et retrouve le temps d’une séquence surréaliste où il se trompe de mots en parlant arabe ce qui faisait le sel de ses caméras cachées : jouer avec le point de rupture du spectateur en lui faisant quitter sa « zone de confort ». Huppert est juste parfaite en flic psychorigide obsédée par le protocole mais qui prend son pied en se bastonnant avec un mari violoniste vaguement consentant – Samy Naceri (re-rires). Et Kiberlain, en godiche lunaire placardisée parce que c’est une « grosse mateuse » tout à fait consciente de son vice, comme elle l’avoue elle-même, est excellente. On sent que ça pourrait déraper à chaque instant, mais tout reste sous contrôle. Avec ce trio remonté à bloc, le réalisateur va exploiter la moindre possibilité, le moindre interstice de l’histoire, pour créer un décalage comique qui provoquera chez le spectateur un tant soit peu ouvert d’esprit – pas un lecteur du Figaro, donc – une jouissance délectable. C’est en cela que les critiques ont évoqué le cinéma de Jean-Pierre Mocky, dernier dinosaure de la vieille garde, malheureusement aphone aujourd’hui, capable de détourner les codes étriqués du cinéma traditionnel pour s’adjuger, via la comédie et l’incongruité, la complicité d’un spectateur blasé. Plus proche de nous, on pense au Mouret des débuts ou encore à La fille du 14 juillet d’Antonin Peretjatko. Et si ces films ouvraient la voie à une nouvelle vague de contrebandiers prêts à exploiter la moindre faille d’une production tellement sclérosée et convenue qu’elle a réussi à faire disparaître chez le spectateur quelque chose d’aussi essentiel que la joie de se laisser surprendre ? Avouez que ça serait pas mal, quand même…