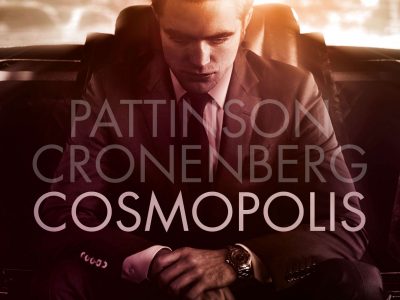La peau du diable
La peau du diable
Le métier de projectionniste permet de découvrir certains films presque par hasard. Cela fait longtemps que je me désintéresse d’Almodóvar. Rien de très excitant depuis le superbe En chair et en os que beaucoup considèrent – à tort – comme mineur au sein d’une filmographie sans surprise conçue pour alimenter les festivals*. Toujours est-il qu’à force, la bande-annonce de La piel que habito a aiguisé ma curiosité, en particulier cette étrange personnage de femme masquée vêtue d’un fuseau noir qui me faisait furieusement penser à Irma Vep dans Les Vampires de Louis Feuillade. C’est donc avec à l’esprit une ambiance de serial du début du siècle dernier que je me suis glissé dans la salle, et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant que le réalisateur ibérique adaptait ici Mygale, un roman noir de Thierry Jonquet aussi dérangeant que passionnant.
L’idée qui porte le film est d’une simplicité exemplaire et s’inscrit totalement dans les thématiques chères au réalisateur : l’apparence n’annihilera jamais l’être qui se cache derrière. Tous les personnages du film en feront l’expérience : la femme du Dr Robert Ledgard, affreusement brûlée alors qu’elle fuyait le domicile conjugal avec son amant, miraculeusement guérie par son mari, se jettera par la fenêtre sous les yeux de sa fille pour fuir le monstre défiguré qu’elle est devenue. L’amant, demi-frère du docteur et cambrioleur en cavale, se présentera à sa mère déguisé en tigre, comme lorsqu’il était enfant, la neutralisera et finira par coucher avec Vera en la prenant plus ou moins pour sa maîtresse défunte. Cette mère, à l’origine domestique au service de la famille Ledgard, n’a jamais osé avouer à Robert qu’elle était sa mère biologique. Lorsque ce dernier la ramène dans la demeure familiale après quatre ans d’absence, elle revêt aussitôt son ancienne tenue de bonne. Cet uniforme, cette peau, c’est le miroir de ses rapport avec ses fils, celui qui a réussit et qu’elle sert, et l’autre, un voyou qui se sert d’elle. La fille, adolescente déboussolée et gavée d’antidépresseurs depuis la mort de sa mère, redeviendra l’enfant qu’elle était ce jour-là lors de la tentative de viol de Vicente, avant de se défenestrer à son tour. Vicente enfin, dont la transformation physique par le bon docteur se double d’un conditionnement mental glaçant. Modelé en femme pour venger le viol de sa fille, Robert lui donne le visage de feu son épouse. Devenu Vera, il jouera la comédie de la femme soumise et aimante. Pour mieux s’enfuir et rejoindre sa mère qui, dans un ultime plan de toute beauté, saura reconnaître au fond des yeux de cette jeune femme en larmes son fils disparu.
Reste le personnage de Robert Ledgard, le seul qui ne changera pas d’apparence au cours du métrage. Intelligemment, le scénario laisse dans l’ombre ses relations avec sa femme au moment de l’accident, et celles avec sa fille avant son agression. Si au départ on se prend de sympathie pour lui, ce sentiment est vite balayé par le jeu glacial d’Antonio Banderas qui livre ici une prestation de haute volée. Quel plaisir de le voir abandonner l’image de beau gosse latino sur le retour dont le regard ténébreux et magnétique enflamma Hollywood! En assumant son âge, ce regard lui permet de composer un personnage ambigu dont la froideur calculatrice et les obsessions malsaines se révèlent au fur et à mesure que le récit progresse. La mise en scène, particulièrement sobre et élégante, est en adéquation avec ce chirurgien esthétique qui n’est pas sans rappeler les savants-fous du cinéma fantastique des années 20. Impression renforcée par la musique envoûtante d’Alberto Iglesias qui fait penser à celle qui accompagnait les film d’épouvante de cette époque.
La piel que habito risque d’être accueilli froidement par les inconditionnels de l’auteur, comme il l’a été à Cannes où les spectateurs semblent avoir été déroutés par sa composante fantastique. Personnellement, je me réjouis à chaque fois qu’un réalisateur prend le risque de se frotter à des univers cinématographiques étrangers. Bien souvent, tout le monde y gagne : l’auteur qui sort de sa routine, le genre concerné dont les codes sont bousculés par un regard neuf, et le spectateur dont la curiosité est récompensée.
* Bon, avant de me faire jeter des pierres, un co-blogeur de mon entourage me tanne avec La mauvaise éducation depuis quoi, sa sortie en salle ? Promis Baptiste, j’y jette un œil dès que j’ai du temps…
La piel que habito de Pedro Almodóvar, Espagne, 2011 avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes…