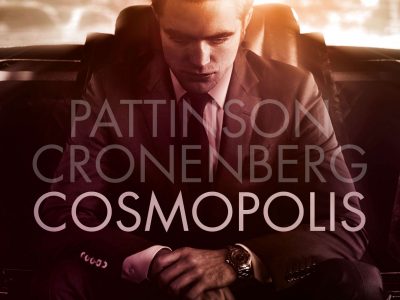Une jeunesse que personne n’écoute
Une jeunesse que personne n’écoute
Quand on considère Bertrand Bonello comme un cinéaste important, qu’on chérie L’Apollonide et le court-métrage Cindy the doll is mine comme des œuvres majeurs, on est embarrassé face au ratage que représente Nocturama.
Pourtant le film est séduisant, comme une variation sur Elephant de Gus Van Sant, avec un sujet qui présente des similitudes, des jeunes passant à l’acte violent, mais aussi par le travail sur la temporalité, une même scène vue par différents personnages sous différents angles, les marches le long de longs couloirs, jusqu’au tee-shirt avec une tête d’animal, référence au célèbre tee-shirt à tête de taureau du film fondateur de Van Sant. On pourrait penser qu’il n’y a rien à voir entre la violence de Colombine et ce dont parle Nocturama, mais finalement pas tant que ça, ce qui est un des problème que pose le film.
Ça commence dans le métro que Bonello filme avec virtuosité, des jeunes qui marchent sans parler, se croisent, regards concentrés ou regards vides, on sait qu’il va se passer quelque chose et on est happé par leur déambulation, comme une sorte de chorégraphie abstraite, scandée par un décompte horaire.
De même, on sait le talent du cinéaste pour filmer des lieux, sa fluidité est étincelante pour faire exister l’espace du magasin où se réfugient les personnages, ainsi la façon dont il utilise la lumière, le choix des morceaux de musique, le travail sur la répétition, est impressionnant. Le cinéaste pourrait choisir de ne faire qu’un film qui avance par rimes poétiques, pulsations, sensations, cherchant la confrontation visuelle et en rester là, sauf qu’il veut dire quelque chose et c’est là où ça coince, Bonello veut faire un film politique, il veut transmettre quelque chose de l’époque dans laquelle on vit, de la jeunesse de notre pays, ainsi Adèle Haenel disant « ça devait arriver » mais sans préciser quoi ni pourquoi ni comment, etc., il ancre le film dans le monde d’aujourd’hui avec cette télévision d’info continue qui cite Valls, par exemple. Le cinéaste se méfie des discours, du didactisme, il ne veut pas nous faire des leçons et c’est tant mieux mais le problème est qu’il veut dire des choses sans les dire, par des images, des symboles. Ça devient à la fois très théorique, sur comment on est rattrapé par le spectacle, la consommation, et en même temps très simpliste.
Le film ne dit rien politiquement.
Des jeunes font des attentats dans une sorte de gauchisme nihiliste assez flou, avec un personnage d’étudiant en science po qu’on pourrait vaguement imaginer comme un potentiel rédacteur de l’Insurrection qui vient (qui a déjà infusé les plus pertinents Le Grand jeu de Nicolas Pariser et L’Avenir de Mia-Hansen Løve, de nombreux échos pour un livre qui n’en mérite pas tant mais qui a pu intéresser Bonello par son romantisme). On les présente d’abord comme très préparés et ensuite ils se retrouvent par une astuce scénaristique dans ce grand magasin, la dichotomie entre l’action réfléchie du début et la stase consumériste de la deuxième partie est artificielle. Une jeunesse prête à s’engager radicalement qui, plongée dans un endroit où tout est disponible, se perd. En une nuit quelqu’un qui fait une action violente pour changer le monde, se rêve d’un coup en costard, ça n’a pas de sens, c’est prendre les personnages pour des imbéciles.
De même on nous montre un groupe qui semble tout faire pour ne pas être identifié, puis un des héros invite un SDF à les rejoindre, comment peut-on croire à ça ? On adhère volontiers à un cinéma qui fuit le réalisme mais là, ça devient juste une idée théorique (le lumpen prolétariat en victime collatéral, un truc du genre) qui va contre ceux qu’il filme, transforme ces militants en des crétins. Bonello a le droit de penser que la jeunesse est dans une grande confusion politique, qu’elle a une colère, une rage (pour reprendre la terminologie insurrectionnaliste) sans savoir quoi en faire mais de là à dire qu’elle n’a aucune pensée, ça ne peut qu’être exagéré et méprisant.
Ainsi ce qui est vraiment gênant c’est le regard sur ces personnages. Ce sont des pantins, ils sont interchangeables, correspondent à des stéréotypes comme s’ils était un panel représentatif d’une jeunesse sacrifiée. Ils ne se passent pas grand-chose entre eux. Quand un des héros voit un mannequin habillé comme lui, comme s’il était son double, on peut y voir une critique de la société de consommation qui annihile l’individu, sauf que c’est le cinéaste lui-même qui les transforme ainsi, c’est son regard qui les réifie, c’est lui qui décide qu’ils n’aient aucun discours politique un tant soit peu élaboré. La jeunesse serait si stupide ?
Dans L’Apollonide, le dispositif formel est transcendé par l’empathie qu’on a pour ce groupe de femmes prostituées, dès le départ Bonello est avec elles, et nous aussi, nous sommes avec elles, de leurs côtés, nous sommes émus par ce qu’elles vivent sans que l’auteur ne cède sur ses choix esthétiques. De même dans Le Pornographe, il y avait une tendre ironie dans le regard de Jean-Pierre Léaud sur de jeunes révoltés. Là, le regard sur ces jeunes manque singulièrement d’empathie, il ne s’agit pas d’être ou non en adéquation avec eux, avec leurs actes, mais de les regarder, de les écouter, de les aimer un minimum. On les voit juste jouer, se grimer, se donner en spectacle comme des coquilles vides. Ainsi quand ils meurent, ils restent ce qu’ils ont toujours été, des mannequins en polystyrène, comme semble le signifier ce plan en bas de l’escalier, où le couple gît. Vivants ou morts, ils ne sont là que pour faire de beaux plans, rien ne palpite. On est glacé par la froideur des exécutions mais presque indifférent à leur sort, tant cela est esthétisé. C’est dommage parce que les acteurs sont plutôt bons et arrivent à donner malgré tout une parcelle d’humanité. La mort du SDF provoque la même sensation d’une idée de mise en scène qui va contre ce qu’il est censé dénoncé. C’est Bonello qui fait de cette mort un spectacle et lui seul.
On est surpris qu’un cinéaste si talentueux ne se rende pas compte en construisant son film qu’il répète avec ses personnages ce que le monde, la société fait avec cette jeunesse. Il ne les regarde pas, leur dénie la parole. La dernière phrase « aidez-moi » s’adresse peut-être à la société mais elle pourrait autant s’adresser à un cinéaste qui a force de « vouloir-dire », de visions poétiques en oublie ceux qu’il filme.
Nocturama de Bertrand Bonello, France, 2016 avec Finnegan Oldfield, Hamza Meziani, Manal Issa…