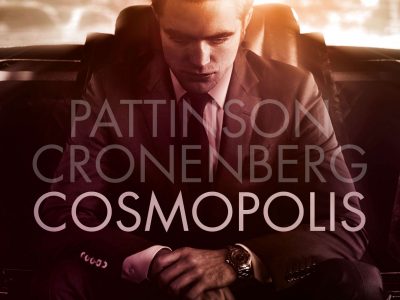Le désamour
Un film français sur une séparation, sur l’amour qui n’est plus là et la haine, l’incompréhension qui le remplacent. Il y avait peu de monde dans la salle de cinéma ce vendredi pour cette deuxième semaine après la sortie du film, on imagine les commentaires « encore un petit film français sur un homme et une femme qui s’aiment puis ne s’aiment plus », l’antienne habituelle des spectateurs français, comme si ce sujet de la séparation, du temps qui use l’amour, de la non-reconnaissance de l’autre qu’on croyait connaître, de la violence qui en découle, etc., ne pouvait être un sujet intéressant, comme si ce sujet n’était pas fondamentale. Cette idée de représenter un cinéma de plus en plus minoritaire est inscrite dans l’histoire de ce film dont les protagonistes sont dans le milieu cinématographique (ainsi cette cinémathèque qui prend l’eau), cela participe à l’émotion qui s’en dégage. Élise Girard continue de faire ce cinéma qu’elle, et nous avec elle, aime même si la mode est au spectaculaire, à l’épate, à la performance, même si ce cinéma là est peut-être en train de mourir. Elle arpente cette page du cinéma français qui sait filmer un sujet minimal dans un lieu (Belleville qui n’est pas filmé comme un décor mais simplement, avec évidence) et un milieu donnés pour toucher à l’universel. Cela donne un film à l’abord peu aimable, faisant sienne l’idée très « nouvelle vague » que la question n’est pas de chercher à faire un bel objet mais une œuvre vivante, elle ne nous prend pas par la main pour nous mener dans son histoire, son montage rapide et elliptique ne nous permet pas d’être happés immédiatement, de même, elle ne cherche pas le naturel, les acteurs jouent en ne cachant pas qu’ils jouent, des regards-caméras à un jeu décalé toujours à la limite de la fausseté, loin de cette idée réactionnaire qu’il faut toujours que « ça ait l’air vrai ». Ainsi cette scène, à priori classique du couple qui écoute une chanson qui leur rappelle le début leur histoire, il s’agit ici d’une chanson chantée par Anna Karina, le plan est fixe, les deux acteurs nous font face, ils chantonnent, rient, pleurent, sont agités de sensations contradictoires, voire de spasmes, nous pouvons imaginer les souvenirs des personnages, peut-être les souvenirs des acteurs, avec l’idée théorique de la nostalgie d’un amour liée à la nostalgie d’un cinéma incarné par Anna Karina, et nous projetons aussi nos propres sensations, nos propres souvenirs de rencontres et d’amours, c’est presque gênant et c’est bouleversant pour cette raison là même, parce que c’est bancal, parce que la scène peut s’écrouler à tout moment, parce que la vie est dans cette imperfection. Élise Girard sait aussi montrer cette femme qui se retrouve larguée dans tous les sens du terme, se retrouvant écartée du décor, le dos contre un mur à épier le monde qui continue sans elle. Cela n’est pas triste parce qu’elle trouve la combativité, la dureté pour revenir en elle et au monde. Les acteurs illuminent le film par leur étrangeté, que ce soit Valérie Donzelli, formidable comme d’habitude, Jérémie Elkaïm ou bien Jean-Christophe Bouvet et Philippe Nahon, irrésistibles en gardiens bougons du temple cinéphilique. Si Élise Girard n’a peut-être pas encore la force d’une grande cinéaste, son cinéma respire et en cette période étouffante, c’est déjà beaucoup. Belleville Tokyo d’Elise Girard, France, 2011, avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm…