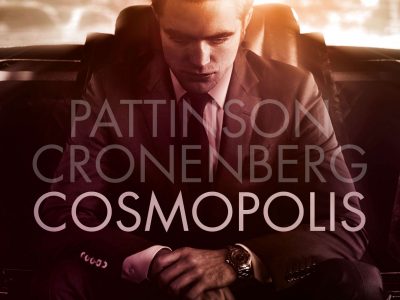En surchauffe
En surchauffe
Deux frères, un, Nick dont le cerveau semble au ralentit, au corps massif qui cache une tristesse profonde, l’autre, Connie, qui va trop vite, qui semble toujours en mouvement, aux aguets, en colère. L’alliance de ces deux êtres qui s’aiment et se soutiennent va les entraîner dans le mur.
Connie, en bon adepte du rêve américain comme il se découvre dans un discours énervé sur les losers, veut quitter la misère, il essaie de s’en sortir en s’activant mais plus il s’active, plus il s’enfonce comme pris dans des sables mouvants. Il y a un certain humour dans cette plongée dans la mouise, un humour grinçant mais jamais cynique, on ne rit (nerveusement) pas contre les personnages, on est avec eux. Connie ne semble pas comprendre ce qui lui arrive et finira hébété comme les spectateurs. Il pensait pouvoir réussir mais il reste un loser, il n’y a pas d’issue. Les héros de Good Time sont pour la plupart des marginaux, ça se passe la nuit au milieu des perdants d’une société violente et inégalitaire. Le monde est poisseux, dur, ça se bat, ça gratte, ça palpite, ça gueule, ça cogne, ça saigne, ça s’aime. Les héros sont dans une logique de survie, et ceux qu’ils croisent sont dans la même logique, ça se débrouille, deale, vole. Il n’y a pas de jugement, tout le monde fait ce qu’il peut. Peu de cinéastes savent filmer la rue et ses marges avec autant de justesse et de puissance que les Safdie, ils filment la pauvreté, la démerde, sans jamais chercher à l’embellir ni à la mépriser, sans discours moral surplombant, sans humanisme rassurant, ni complaisance, ni condescendance, on est juste là où ça se passe, où ça vibre, on est juste là en empathie avec les personnages (comme avec l’héroïne voleuse de The Pleasure of Being Robbed, avec le père perdu de Lenny and the Kids où les amoureux drogués et autodestructeur de Mad Love in New York, les précédents films indispensables des cinéastes) et de prendre des acteurs célèbres comme Robert Pattinson ou Jennifer Jason Leigh, comme le fait de se coltiner au genre du film de braquage, ne change rien à leur regard sur le lumpenproletariat. Ils regardent ce monde avec suffisamment d’amour pour ces paumés magnifiques pour qu’on soit profondément touché par ce qui leur arrive.
Parfois le filmage à l’arrache, à l’épaule tient lieu d’unique choix de mise en scène pour certains cinéastes peu imaginatifs voulant faire du cinéma coup de poing, tripale, ce n’est pas le cas ici, la mise en scène paraît au premier abord brute, rêche, au plus près des corps, des visages, toujours en mouvement mais il y a beaucoup plus que ça, il y a un travail sur les couleurs, sur leur saturation, sur le trop qui correspond à ce qui se passe dans la tête de Connie, où tout semble toujours aller trop vite, des couleurs primaires vives, du rouge, du jaune, du bleu, en aplat, des couleurs baveuses et pimpantes dans la noirceur d’une nuit qu’on ne quitte qu’à quelques instants, le travail sur la lumière est vraiment très beau, des reflets venant des téléviseurs, des feux rouges, la peinture qui éclate dans une voiture, des vitraux apparaissant en arrière-fond d’un couloir d’hôpital, ou les néons d’un parc d’attraction, etc, il y a une vraie recherche picturale qui n’est jamais ostentatoire. Le travail sur le son est tout aussi impressionnant, une musique omniprésente qui n’accompagne pas le film mais qui est une partie aussi importante que la partie visuelle, une musique stridente, qui crée une tension permanente et qui s’arrête parfois et là aussi la captation des sons, comme ceux des machines d’un hôpital par exemple, est très précise.
Le montage est tendu, on est comme en apnée, on a du mal à respirer au diapason d’un héros en surchauffe, qui semble fourmiller d’idées, on sent une pulsation dans le corps des acteurs (tous justes et intenses), on la sent presque physiquement. Les Safdie savent jouer sur les ruptures de rythme, tourner une première partie sous la forme d’un thriller sous amphétamine, ultra efficace pour ensuite prendre des chemins de traverse où la vie explose de partout, comme dans cette appartement où le héros se réfugie, il en faut peu par exemple pour faire exister ce personnage d’adolescente fataliste, on pourrait parler aussi de ce mini film (qui semble en vitesse accéléré) dans le film quand une personne rencontrée (de façon accidentelle) raconte comment il s’est retrouvé à l’hôpital. Et la dernière scène emporte tout, en écho à la toute première, elle est déchirante, ce retour au calme suite à la course folle de Connie est d’une tristesse et d’une noirceur infinie, tout est rentré dans l’ordre, tout le monde est à sa place, les désirs sont entravés, doit-on s’en réjouir ? Cette scène finale alors que le générique défile et que la voix d’Iggy Pop nous bouleverse, aurait pu mériter à elle-seule qu’on donne la palme d’or à Good Time, mais tant mieux, ils n’ont pas besoin de ce genre de distinction pour être aujourd’hui des cinéastes majeurs.
Oui, les frères Safdie sont bien les enfants bâtards de Cassavetes (comme tous les cinéastes étiquetés comme mumblecore) et Scorcese (on pense parfois à After hours entre autres), on peut trouver pire comme parrains. Ce ne sont pas les seuls rejetons de ces cinéastes mais ils en sont, assurément, les plus talentueux, tant ces influences évidentes ne les empêchent pas d’avoir un univers et un style très personnel qui nous foudroient.
Good Times de Joshua et Ben Safdie, EU, 2017 avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh, Taliah Webster, Buddy Duress…