 Une si jolie sauvagerie
Une si jolie sauvagerie
Une petite fille et son père dans un lieu qui risque d’être immergé, une ile au milieu du bayou, menacée par les orages et le réchauffement climatique.
Le début intrigue, on est plongé très vite dans un monde étranger ou tout semble bancal, en mouvement, dans des baraquements de bric et de broc, un monde où les règles paraissent différentes.
Malgré l’originalité du projet, très vite tout semble attendu. Malgré l’aspect bordélique, on n’échappe que rarement au programme.
La nature est belle et hostile, le peuple de miséreux est bourru, alcoolique, bruyant mais plein de vie et d’amour, la petite fille est mignonne et toute en force et volonté. Les retrouvailles finales avec le père pourraient être touchantes mais tout a été tellement construit pour qu’on en arrive là qu’on regarde la scène avec plus de détachement qu’on ne le voudrait.
Plus gênante est cette vision des pauvres comme des animaux qui s’accrochent à leur tanière et qui ont bien raison face à la civilisation capitaliste symbolisée par ce centre hospitalier dans lequel ils sont recueillis. On voit bien l’idée que les bêtes sauvages c’est surtout les soldats de cette civilisation qui empêche l’humain de s’exprimer, qui étouffe son énergie, sa vitalité, sa capacité de révolte.
Si la digue est une matérialisation claire de la lutte des classes, d’un autre côté, s’il n’y avait pas la pluie qui emporte tout, il n’y aurait pas de problème, que chacun reste à sa place et tout le monde est content. Ainsi la révolte politique que le film pourrait contenir est balayée par cette catégorisation des personnages, cet étiquetage social trop marqué.
Ça fait parfois penser à certains films de Kusturica, sauf que ce dernier donne l’impression d’être au milieu du bordel, d’en faire partie, il ne regarde pas de haut des humains/animaux même si c’est pour en tirer une beauté sauvage, il est un animal parmi les autres, et cette impression de non maitrise des films du genre de Chat noir, chat blanc donne quelque chose de réjouissant, ici le cinéaste se voudrait aussi au centre des choses, mais on perçoit les intentions, la distance.
Ainsi le metteur en scène veut un filmage direct, être au plus près, dans un style qui se veut documentaire. Alors la caméra virevolte, ne se pose jamais, mais cette façon de filmer ne surprend pas non plus, c’est ce qu’on attend de ce type de film, le côté choppé sur le vif alors que ça semble très construit. De même l’aspect magique et métaphorique des aurochs impressionne mais ça paraît en même temps assez vain et la symbolique est parfois un peu lourde, on sent la volonté d’en mettre plein la vue avec énergie, puissance.
Bien sûr certains plans sont saisissants, on ressent physiquement la violence de l’orage et le sentiment de plénitude lorsque le calme revient alors que l’eau a recouvert le sol et que l’héroïne et son père navigue sur un bateau de fortune. De même l’arrivée étrange des quatre filles dans un bordel posé on ne sait où crée un réalisme fantastique surprenant, et la danse qui suit entre Hushpuppy et une femme qui pourrait être sa mère est émouvante parce qu’elle prend son temps, parce que ça respire un peu, parce qu’il y a de l’incertitude.
Ainsi un film étrange, parfois très beau, et en même temps parfois ennuyeux parce que trop conforme à ce qu’on pourrait attendre de cette étrangeté.
Les Bêtes du Sud sauvage (Beasts of the Southern Wild) de Benh Zeitlin, EU, 2012 avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry…
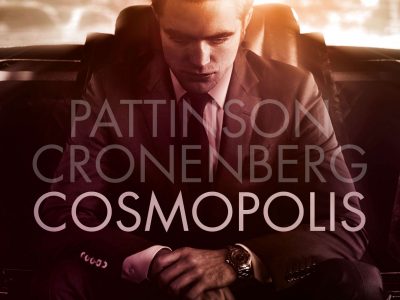


je ne voyais pas une matérialisation aussi claire de la lutte des classes mais maintenant que je le lis…pourquoi pas.
Je suis d’accord : film sans surprise et « que chacun reste à sa place ».