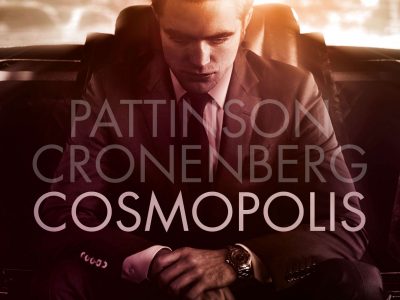Sur une route balisée
Ce film était un des principaux favoris au festival de Cannes pour la palme d’or, la plupart des critiques l’ont décrit comme un chef-d’œuvre et le public a suivi mais on peut être surpris par cet unanimisme.
La première partie de Drive my car est séduisante dans sa mise en place, ce prologue avec le surgissement de la scène adultérine, la mort soudaine de la femme du héros, et le départ vers Hiroshima. C’est très sec, efficace et traversé d’une étrangeté qui éveille l’attention.
Une fois arrivé à Hiroshima où le héros, Yûsuke Kafuku va mettre en scène Oncle Vania, on devine assez vite où on nous emmène. Le héros va devoir être emmené par une chauffeuse douée et effacée. Si la rencontre avec cette conductrice est plutôt touchante, l’impression de suivre une voie toute tracée s’intensifie au fur et à mesure, on comprend que ces deux personnages renfermés vont finir par se dévoiler, se confier et qu’alors adviendra une émotion forte, etc., tout semble aller dans ce sens. Le cheminement est fléché et le film ne dérogera pas au programme qu’il s’est fixé.
Tout est censé faire sens, aucun élément ne semble là au hasard mais chacun doit signifier quelque chose à un moment ou à un autre, et cela devient étouffant, ainsi que cette caractéristique très à la mode de donner l’impression de peu expliquer tout en soulignant tout.
Deux exemples parmi d’autres. Le premier, Kafuku et sa conductrice sont tous les deux dans la voiture, un rapprochement se fait, il lui permet alors de fumer une cigarette, ce qui lui refusait avant, on voit la voiture de face dans un plan large et tremblant, elle tend son bras par l’ouverture du toit pour que la cigarette n’abîme pas la voiture, il fait de même. Le plan est beau, furtif, comme volé, ça pourrait s’arrêter là, mais dans le plan suivant, on voit les deux mains en gros plan pour ceux qui n’ont pas compris ce qu’on devait ressentir et penser à ce moment-là sur cette complicité qui se construit. Deuxième exemple, dans la même voiture, lorsque le héros parle de l’âge qu’aurait sa fille disparue soit le même que celui de la conductrice (ce qui n’est pas non plus d’une grande subtilité), on nous montre bien son regard dans le rétro pour ceux qui n’auraient pas fait la connexion.
Elle a perdu ses parents, il a perdu sa fille, etc. Dans Hiroshima la ville du deuil, alors qu’il joue une pièce sur la vie, la mort, le temps qui passe, etc. Il a un glaucome après avoir vu sa femme avec un autre homme. Le héros a engagé l’ancien amant de sa femme pour jouer son rôle, et on attend la discussion entre les deux qui est au final qu’un monologue à la fois mystérieux et signifiant. Il ne veut plus jouer Vania suite à la mort de sa femme, mais cette place se libère, va-t-il la reprendre, etc.
Lorsque ces éléments disparates finissent par s’assembler, le film met à nu sa mécanique volontariste.
Ainsi tout devient empesé, jusqu’à la dérive finale entre la conductrice et son passager avec des dialogues qui sont de longues tirades pendant lesquelles ils expliquent leur trauma respectif et, acmé émotionnelle pour faire pleurer dans les festivals, arrive ce moment si peu surprenant où les deux se serrent l’un contre l’autre, acceptant la réalité du deuil et sa part de culpabilité. Dans un paysage enneigé, la neige comme symbole, encore un, de ce qui est enfoui. Cela sonne alors comme plaqué, non vécu, non ressenti. Cela n’existe pas parce qu’on sent l’intention du cinéaste en permanence. Pour finir par ce dernier plan sur cette femme muette jouant en langage des signes avec le héros qui a évidemment choisi de revenir jouer Vania au théâtre. C’est très beau, très élégant, très bien pensé mais ça ne vit pas. C’est fait pour plaire, pour qu’on pense que ce plan est beau, et il faut croire que ça a fonctionné vu les éloges que le film a reçus, c’est un film qui suit des rails, qui le fait très bien, mais qui ne prend pas de risque.
Bien sûr, Hamaguchi a du talent, de nombreux plans sont d’une grande force, ainsi ces plans de neige dans le silence, ces plans de circulation, ces entrées dans les tunnels, la route qui serpente proche de la mer, cet arrêt dans la déchetterie, cette séquence d’audition du jeune Koji , etc. Ainsi que cette séquence de répétition dans un parc avec la conductrice en arrière-plan est belle, comme apaisée. Mais là aussi la scène était annoncée en amont par le désir énoncé de la conductrice de voir les répétitions. Tout est calibré, bien construit, mais pour qu’il y ait une émotion, il faut qu’on soit surpris, qu’il y ait des chemins de traverse, des sorties de route, que ça bifurque, déborde.
Pour être bouleversé par un film sur le deuil, dans le sens aussi d’être bougé, mieux vaut aller voir Serre-moi fort de Mathieu Amalric, mais pour cela il faut accepter de se perdre, d’oublier ses repères. Tout ne paraît pas aussi maîtrisé et cela émeut profondément de ne pas savoir où l’on va.