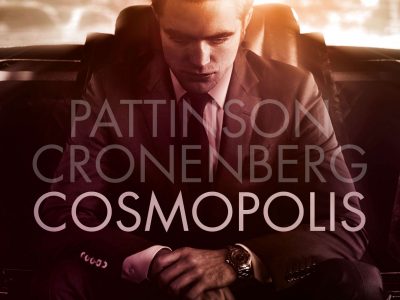Gonflé
Gonflé
Jusqu’ici Quentin Dupieux me laissait froid. Pas vraiment porté sur sa musique, j’ai tourné le dos à Steak pour cause d’allergie à Eric et Ramzy. Pour moi, il n’était que le énième produit de ces écoles des beaux-arts qui vous apprennent à être un « artiste » en regardant votre nombril. Si je suis allé voir Rubber, c’est pour résoudre un étrange paradoxe : le film a été mis en avant par Les Cahiers du Cinéma et par Mad Movies, deux revue assez rarement d’accord. Mais Rubber, qu’est-ce que c’est au juste ?
Déjà, Rubber n’est pas une installation d’art contemporain. Cette possibilité est désamorcée dès la première scène où un homme portant plusieurs paires de jumelles attends devant des chaises placées en quinconce sur une piste dans un coin de désert. Une voiture de police arrive, commence à slalomer très lentement et heurte chaque chaise qui s’écroule, le tout filmé en plan fixe. La voiture stoppe, un shérif sort du coffre et interpelle le spectateur face caméra. Il nous explique la théorie cinématographique du « no reason », à savoir que dans certains films, les choses sont comme ça et il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Tentative de se dédouaner par avance d’un des pitch les plus étonnant de ces dernières années? Non, pur élément de mise en scène puisque le contre-champ de cette séquence, ce n’est pas nous mais un groupe de personnages hétéroclite que nous appellerons « les spectateurs dans le film ». Mise en abîme assez cocasse, car si nous découvrirons les aventures du pneu Robert sur un écran de cinéma, eux les suivent en live à la jumelle et ne se privent pas de commenter ou d’intervenir dans l’histoire.
Rubber n’est pas non plus un film de genre ; il en empreinte des mécaniques – notre pneu fait exploser les têtes de ceux qui ne lui reviennent pas –, en détourne certains codes avec beaucoup d’humour, comme par exemple « l’évicération » d’une dinde cuite par les spectateurs affamés qui renvoie immédiatement aux films de zombie, mais la parenté s’arrête là.
Rubber n’est pas une énième production « low cost », à savoir un film tourné avec un budget ridicule, filmé avec des moufles et destiné à décrocher le jackpot en salle (un exemple récent? Le calamiteux Paranormal Activity). Si Quentin Dupieux a utilisé un appareil photo, un trépied et une équipe ultra-réduite, il est parti tourner dans un désert étasunien et les acteurs, impeccables, sont le fruit d’un casting rigoureux. Et surtout, surtout, les qualités cinématographiques du film sont indéniables. On sent une maitrise totale du Canon 5D Mark II qu’il pousse dans ses derniers retranchements. A ce titre, le début du film est magistral, depuis les plans fixes de la décharge jusqu’à ce que Robert rejoigne la route et tombe amoureux de Roxane Mesquida – qui a bien grandi depuis A ma sœur. Dupieux démontre une maîtrise parfaite de la lumière naturelle et de la mise en scène pour un résultat qui n’a rien à envier aux grosses productions traditionnelles.
Mais alors Rubber, c’est quoi ? Ben juste un film original. Simple, sans concessions, sans facilités destinées à caresser financiers et grand-public dans le sens du poil. Alors oui, il y a une petite chute de rythme en cours de route – astucieusement montrée du doigt par le dernier spectateur vivant – et il ne fallait pas que ça dure plus longtemps. Ne boudons pas notre plaisir : un musicien nous prouve qu’un autre cinéma est possible ; et avec un appareil photo, en plus! Je vous laisse, il faut que je m’auto-flagelle en regardant Steak…
Rubber de Quentin Dupieux, Fr, 2010 avec Stephen Spinella, Roxane Mesquida